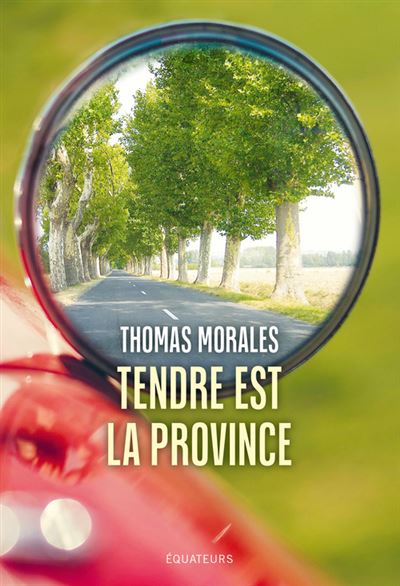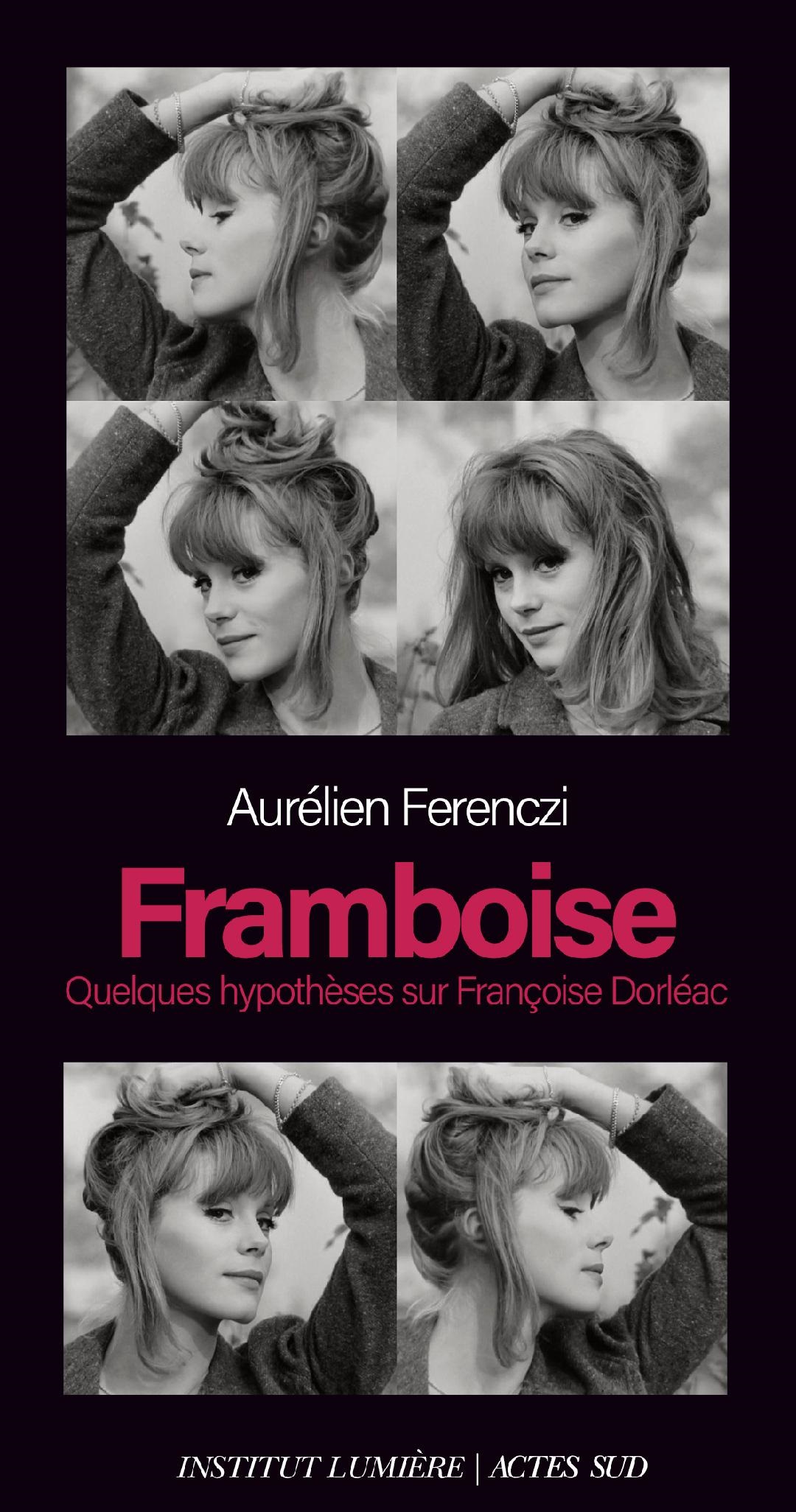« Quoi de neuf ? Broca! »
« Quoi de neuf ? Broca ! »
L’écrivain Thomas Morales avait déjà évoqué le cinéma de Philippe de Broca dans Monsieur Nostalgie. Il récidive dans un chapitre de son nouveau livre, Tendre est la province aux éditions des Equateurs. En voici le texte :
« Quoi de neuf ? Broca !
Depuis une dizaine d’années, je m’efforce de rendre à Philippe de Broca la place qu’il n’a pas dans les rétrospectives ; trop fin, trop commercial, trop populaire, trop provincial, trop virevoltant aussi, frénétique et mélancolique, joueur et fuyant, aristocratique et primesautier, à fleurets mouchetés, ce cinéma d’émotion et d’action n’a pas les faveurs d’une critique qui ne comprend que l’entonnoir sur la tête et les manuels d’agit-prop. Il condense tout ce qui horripile les torquemadas de la caméra, le marivaudage zébré d’incertitudes, le boulevard sentimental, la course à l’échalotte, la cascade et les blagues des copains, le juste balancier entre un dialogue qui serait trop écrit et des sauts de cabris. Moi, ce cinéma-là m’émeut au plus haut point.
Lui seul sait filmer une place de village dans son indolence souveraine. J’y puise une force et une échappatoire, il est tout ce que le cinéma d’auteur abhorre : léger, sensuel, polisson, sensible, jamais racoleur, jamais misérabiliste, dansant et feutré, non-victimaire et aboyant. Il est ma France. Jean-Pierre Cassel cabotine dans Les Jeux de l’amour, Le Farceur et L’Amant de cinq jours, Belmondo nous épuise dans L’Homme de Rio ou Cartouche, Geneviève Bujold nous arrache des larmes dans Le Roi de cœur avec son tutu fichu, Montand qui m’est antipathique m’amuse dans Le Diable par la queue, Jacqueline Bisset est à double-face dans Le Magnifique, au pinacle de son érotisme en nuisette de soie ou en pull à grosses mailles, Marthe Keller est cette brindille haletante dans Les Caprices de Marie en maillot de bain deux pièces, Jean Rochefort roule en break Volvo 145 dans Le Cavaleur ce qui est en soi, le signe d’une élégance folle et d’un caractère extatique, je pourrai continuer encore longtemps cette liste à la Prévert, cette fantasia de l’enfance.
« Je ne peux pas me revendiquer de la Nouvelle Vague dans la mesure où je suis un cinéaste populaire, quelqu’un qui veut faire des entrées, qui veut faire rire, qui veut avoir du succès…La Nouvelle Vague voulait essentiellement faire du neuf […] Ce qui est bizarre, c’est que, pour les gens du cinéma, plus on se rapproche du public, plus on doit faire vulgaire » concédait-il, dans un entretien accordé à Alain Garel et Dominique Maillet. Broca est la parfaite antithèse de toutes les théories brumeuses d’un cinéma cultureux et protestataire.
Dans un film de commande, il se révèle douloureusement personnel et dans un film plus personnel, il injecte une dose d’universalisme. Prenons, Tendre Poulet avec Philippe Noiret et Annie Girardot, la rencontre entre un professeur de grec ancien à la Sorbonne et d’une commissaire de police, l’histoire est
amusante, la péripétie policière se regarde avec plaisir, les acteurs sont à l’aise, les Monique Tarbès et Roger Dumas font leur numéro avec cette fantaisie cabaretière qui n’existe plus, ne croyez pas que ce cinéma en apparence inoffensif, se regarde et s’oublie. Il n’est pas jetable. Il dit tout de nous, de nos méandres, de notre incapacité à s’engager, de nos rêves enfouis, de nos absences et de nos fuites imbéciles, sans grands mots à la rescousse, sans les larmes abondantes des atrabilaires, sans les aplats de couleurs glauques, mais dans l’organdi et le crêpe, l’ondoiement, le drapé, un travail de dentellière. Quand je m’arrête square Viviani, observer l’avancement des travaux de la Cathédrale Notre-Dame, je suis emporté par une émotion qui déborde, je ne peux la retenir. Noiret invite Girardot à l’accompagner sur une plage de Normandie, c’est bon paraît-il pour les couples, dans son costume en seersucker, un cornet de glace à la main, il tente un rapprochement. Nous ne sommes pas dans la drague lourdingue, la déconstruction et le procédural. Ce moment fugace où deux personnes se rencontrent avec les sous-entendus et les piétinements sous-jacents, est superbe de maîtrise. C’est rapide, farfelu, boiteux, d’une beauté à crier. »
« Tendre est la province » de Thomas Morales, Editions des Equateurs, 2024. 240 pages, 19 euros.